Accueil > Editions & Publications > le libertaire > Le libertaire n°201 daté du 4 novembre 1949 > Politique et pédagogie : Freinet et les Anarchistes
Politique et pédagogie : Freinet et les Anarchistes
vendredi 24 mai 2024, par (CC by-nc-sa)
Deux collaborateurs du Libertaire, deux anarchistes, se sont occupés récemment de Freinet et de son œuvre, avec toute la tolérance et l’effort de compréhension naturels chez des hommes qui luttent pour rétablissement d’une société fraternelle. Le premier de ces articles soulignait la contradiction existante entre les principes pédagogiques et l’appartenance au parti communiste de l’instituteur de Vence, et concluait que si celui-ci devait vivre d’accord avec les principes politiques qu’il défend, il chercherait bientôt des principes plus en harmonie avec son œuvre d’éducateur. Le deuxième narrait la lutte courageuse soutenue par lui contre la réaction locale. Dans les deux cas, la sympathie la plus complète était exprimée, et nous pourrions, si nous nous en donnions la peine, trouver d’autres témoignages venant des anarchistes envers celui qui, à mon avis, aurait beaucoup moins de renommée dans un pays ou la pédagogie a fait des progrès réellement importants, mais qui n’en est pas moins, en France, et à cette époque, un combattant auquel nous rendons hommage.
Pourquoi faut-il que cette tolérance ne soit pas réciproque, et que cet homme avec qui, indépendamment de ses conceptions sociales, nous nous sentons solidaires, se soit conduit envers nous d’une façon lamentable ? Voici, en effet, ce que nous trouvons aux pages 17-18 du petit livre Conseils aux Parents, dont il est l’auteur, à propos des anarchistes et de l’anarchisme :
Nous avons eu, dans notre école, un garçon de onze ans. Ka, fils de parents anarchistes de race [1] qui étaient désespérés de ne rien pouvoir tirer de lui. Ka, qui ne manquait cependant pas d’intelligence, semblait froid et indifférent à tout, trop tôt désabusé, comme déjà las de vivre.
Dès son plus jeune âge, Ka avait été malgré lui imprégné par cette atmosphère d’insécurité dans laquelle vivaient ses parents, sans cesse traqués, vivant en marge de la société, pratiquant en permanence et de parti-pris le mensonge social et politique, obligés de se travestir parfois pour fuir, de se cacher, de cacher des complices, et, le cas échéant, de jouer du revolver.
Ka n’avait pas essayé de comprendre, et il n’aurait d’ailleurs pas pu. Il avait vécu ses premières années dans une atmosphère familiale et sociale tout à fait différente de l’atmosphère normale. Sa nature n’avait connu ni la sincérité, ni la vérité. Intuitivement, subconsciemment, Ka avait été persuadé que le propre de la nature humaine, l’essentiel de sa moralité, c’était cette duplicité permanente qui avait été autour de lui la grande règle de vie. Pour ce qui concerne le travail, notamment, il avait été profondément influencé par des théories et des pratiques qui en étalent comme sa condamnation sociale.
Et de fait, Ka n’était plus perméable à la droiture, à la sincérité, à ce que nous appelons la vérité. Il mentait par nature, comme d’autres disent la vérité par nature. Lui parler de vérité était aussi vain et inutile que de parler de couleur à un aveugle. C’était là des notions qui étaient étrangères à son comportement fonctionnel.
Il en était de même pour le travail qu’il considérait malgré lui comme une chose antinaturelle, à laquelle on ne se résout que lorsqu’on y est contraint — parce que le comportement familial avait déterminé en lui ces règles de la vie.
Si, dans l’exemple qu’il cite, Freinet avait dit qu’il s’agissait d’un cas particulier, d’une famille anarchiste illégaliste qui, comme tous les illégalistes, quels qu’ils soient, sont obligés de vivre, et vivent dans les conditions anormales, nous n’aurions pas à protester, quoiqu’il soit absolument inexact que la vie illégale ait fatalement de tels résultats. Pour la loyauté de la discussion, nous admettons qu’il s’est trouvé des individus qui, se réclamant de l’anarchie, ont vécu dans des circonstances à peu près semblables à celles qu’il décrit. Mais ce furent des cas exceptionnels, et Freinet parle d’« anarchiste de race » c’est-à-dire de véritables anarchistes. Fatalement, la majorité de ses lecteurs doit supposer que les anarchistes véritables sont des gens malhonnêtes, dissimulateurs, paresseux par principe, qui, volontairement, tournent le dos à toute règle d’éthique individuelle, et sont des parasites sociaux.
Qu’un homme exerçant la fonction la plus noble que l’on puisse exercer : celle d’éduquer l’enfant, de préparer des hommes meilleurs pour un avenir meilleur, ait écrit de telles choses, voilà qui nous dépasse. L’écrivain espagnol Blasco Ibanez disait que la famille Reclus honorait l’humanité. C’est dans cette famille que l’on pouvait parler d’anarchistes de race. S’il s’était un peu informé, s’il avait lu un tant soit peu Proudhon, s’il avait connu sa simple formule « l’atelier remplacera le gouvernement », Freinet aurait compris qu’on ne pouvait pas présenter les anarchistes comme des hommes systématiquement ennemis du travail, défendant des théories et des pratiques qui en étaient ia condamnation sociale
. S’il avait lu L’Ethique de Kropotkine, ou simplement sa brochure La Morale anarchiste, il aurait évité de nous présenter comme ennemis de la droiture, de la sincérité, de la vérité. C’est dans cette brochure que Kropotkine disait aux jeunes :
Sème la vie autour de toi. Remarque que tromper, mentir, intriguer, ruser c’est t’avilir, te rapetisser, te reconnaître faible d’avance, faire comme l’esclave du harem qui se sent inférieur à son maître.
S’il avait lu... Mais Freinet avait-il lu les hommes qu’il condamnait de façon si péremptoire ? Connaissait-il les idées et les théories sur lesquelles il portait un jugement comparable à celui des policiers des pires régimes réactionnaires ? Et même s’il a connu une famille d’anarchistes dont, il nous fait une description plus ou moins rocambolesque, était-il digne d’un homme intelligent et cultivé, qui par son rôle social doit être capable de distinguer les cas d’espèce des cas généraux, de généraliser aussi hâtivement ?
Freinet devait savoir que l’immense majorité des anarchistes travaillent de leurs mains et de leur cerveau. Si certains vivent illégalement, ce n’est pas toujours par principe, mais parce que les conditions dans lesquelles la société les a placés, les y obligent. Mais quand Staline pratiquait les expropriations, ne vivait-il pas illégalement ? Mais Lénine, Trotsky, Krassine, et combien d’autres bolchéviques n’ont-ils pas vécu illégalement ?
Nous sommes si peu partisans du mensonge, de la dissimulation, de l’hypocrisie que nous avons toujours été révoltés par la recommandation que Lénine en faisait dans La Maladie infantile du Communisme. Ce qui, très souvent a en effet différencié les anarchistes des marxistes dans leur attitude sociale, c’est que les premiers ont placé l’éthique avant la politique, et que les deuxièmes ont agi inversement.
Mais puisque nous avons affaire à un pédagogue qui nous niait — nous nie-t-il encore ? — toute qualité morale, je veux lui prouver que les anarchistes ont poussé leur souci d’élévation individuelle et sociale jusque sur le terrain qui lui est propre ; sur un terrain qui ne ressortissait pas de leur profession. J’ai écrit que le pédagogue exerce la fonction la plus noble que l’on puisse exercer. Or, non seulement les anarchistes travaillent, mais sans y gagner leur vie, payant, au contraire, de leur argent, de leur tempe, de leur liberté et même de leur existence ; ils ont, et bien avant Freinet, lutté pour une pédagogie nouvelle.
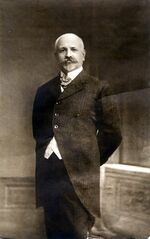
Je laisserai de côté les idées que l’on peut trouver chez Kropotkine et chez Reclus. Je parlerai des réalisations. Avez-vous, Freinet, entendu parler de l’anarchiste Francisco Ferrer ? Non seulement il apporta sa part d’idées nouvelles, mais en pleine Espagne monarchiste et réactionnaire, il fonda des centaines et des centaines d’écoles pour combattre l’enseignement catholique et étatise. Il fut aidé par des libres penseurs de différents pays, mais il compta parmi ses collaborateurs les plus dévoués, les anarchistes Elisée Reclus, Jean Grave, Charles Malato, et celui qui fut, en Espagne, son bras droit, Anselmo Lorenzo. Il fut, dans ce pays, aidé constamment par les groupements et les syndicats anarchistes. Ce n’est qu’en eux, ses camarades, qu’il eut un appui constant. Et ce sont eux qui, après que ce grand réalisateur eût été fusillé dans les fossés de Montjuich par ceux qui voulaient tuer en sa personne l’« Escuela Moderna », ont continué son œuvre.
J’ai eu l’honneur d’être, à La Corogne, maître dans une des quelque cinquante écoles que les groupements et les syndicats libertaires continuèrent à maintenir au prix de sacrifices innombrables, tant sous la monarchie que sous la République. Cette école avait été fondée et était maintenue par le syndicat des marins et débardeurs appartenant à la C.N.T. D’autres fois c’étaient des syndicats libertaires de paysans, des Athénées libertaires qui les fondaient et les soutenaient. Et pendant la révolution espagnole, au moins mille cinq cents écoles ont été fondées par les collectivités libertaires combattues avec acharnement par vos camarades de parti.
Avez-vous entendu parler de La Ruche, fondée avant la première guerre mondiale par Sébastien Faure ? Avez-vous entendu parler de l’œuvre de Madeleine Vemet ? Vous n’ignorez pas je suppose, l’expérience de Tolstoï, anarchiste chrétien, mais anarchiste, à Yasnaïa Poliana. Et partout, en Europe comme en Amérique du Sud ou au Japon, les anarchistes se sont occupés de l’enfance, et des problèmes qui se posaient à la pédagogie.
J’irai plus loin. La pédagogie moderne est foncièrement libertaire. La doctrine que vous condamnez d’une façon si surprenante se retrouve dans les conceptions de John Dewey et ses amis d’Angelo Patri, de Ferrière, de Decroly, et en partie chez la Montesori. Le Plan de Dalton et foncièrement libertaire, — quoiqu’il n’avait pas pris ce nom, il repoussait toute forme d’État et d’autorité gouvernementale —, Robert Owen, qui fonda les premiers jardins d’enfants, et leur premier généralisateur, Froebel, fut un disciple de Fourrier, précurseur de l’anarchiste.
Et tous ces hommes, tous ces théoriciens, tous ces réalisateurs ont communié dans un même esprit, une même aspiration qui se sont dégagés et de plus en plus affirmés : découvrir et développer ou faire développer, en l’harmonisant avec les besoins de la vie sociale, la personnalité de l’enfant. Et tous ces théoriciens et tous ces réalisateurs ont, systématiquement éliminé les vieilles formes autoritaires pour les remplacer par l’initiative induvisuelle et collective et le « self gouvernment », afin que l’enfant soit le plus possible un libre investigateur, une intelligence créatrice, une volonté consciente.
Tout cela, c’est de l’anarchie qui s’ignore presque toujours, mais de l’anarchie. Et les instituteurs libertaires que j’ai vus, en Amérique du Sud, appliquer avec enthousiasme les doctrines pédagogiques nouvelles, et les discuter dans les congrès où ils étaient souvent parmi les principaux animateurs, y voyaient une concordance absolue avec leurs conceptions sociales qui, vous le voyez Freinet, n’étaient pas l’immoralité et la fainéantise élevés à la hauteur de principes.
Dans votre petit livre, vous vous déclarez partisan de l’autorité. Mais dans la mesure où vous êtes un pédagogue moderne, non en ce qui concerne la technique du travail — sur ce terrain, les Jésuites font des merveilles, et depuis longtemps —, mais quant à l’esprit et aux buts de l’enseignement et de l’éducation, vous êtes, vous aussi, un anarchiste. Vous êtes un pédagogue moderne selon que vous remplacez l’autorité par le conseil, par la direction alliée à la liberté, par le travail commun où la supériorité intellectuelle ne se manifeste pas autoritairement, et tend à rendre les enfants et les futurs adultes capables de ne pas avoir besoin d’elle.
Cela, c’est de l’anarchie en action. Toute la pédagogie moderne en est imprégnée, et elle pénètre même dans bien des écoles de l’État par l’intermédiaire d’instituteurs et d’institutrices qui tendent de plus en plus à devenir les camarades de leurs élèves à mesure que ceux-ci avancent en âge.
Les anarchistes n’ont donc pas à apprendre la loyauté, la morale digne de ce nom, la droiture, la sincérité. Ils n’ont pas à apprendre l’obligation du travail que Bakounine réclamait pour tous en proclamant Qui ne travaille pas est un voleur
. Et ils se sont aussi, depuis longtemps, au prix de sacrifices que vous ignorez, Freinet, occupés de l’enfance, et de la pédagogie. Peut-être, s’il parait une deuxième édition de Conseils aux Parents, atténuerez-vous ce jugement que la passion politique et une généralisation bien peu scientifique, sinon une ignorance inadmissible pour l’homme responsable qui juge les autres, vous ont fait porter sur nous. Mais, quelle que soit votre attitude, nous n’en continuerons pas moins à défendre votre œuvre dans ce qu’elle a d’utile et de courageux. Et notre attitude prouvera à ceux qui nous lirons impartialement que la droiture, la vérité et la sincérité sont les qualités morales qui inspirent, fondamentalement, les « anarchistes de race ».
[1] C’est moi qui souligne.
 PARTAGE NOIR
PARTAGE NOIR
